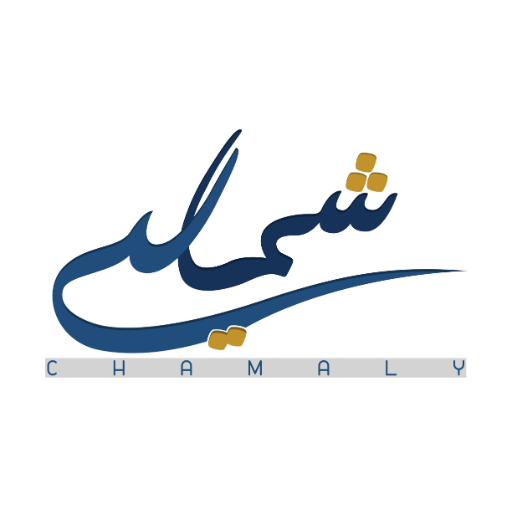Dans une déclaration marquante, Nizar Baraka, ministre de l’Équipement et de l’Eau, a révélé lors de la session des questions orales à la Chambre des représentants, que la part de l’agriculture dans l’utilisation des ressources en eau est passée de 85 % à 55 %. Cette annonce soulève des questions fondamentales sur l’impact réel du secteur agricole sur la crise hydrique que traverse le pays et remet en question les accusations précédemment adressées à l’opposition lorsqu’elle soulevait ce problème.
Depuis des années, un débat persistant existe sur le rôle de l’agriculture dans l’épuisement des ressources en eau. L’opposition a maintes fois affirmé que les politiques agricoles adoptées, notamment l’encouragement des cultures fortement consommatrices d’eau, telles que l’avocat et la pastèque, étaient une cause majeure de l’aggravation de la crise hydrique. Toutefois, au lieu de reconnaître le problème, les réponses officielles ont souvent minimisé l’ampleur de la situation et accusé l’opposition de faire de la surenchère politique.
Aujourd’hui, la déclaration du ministre de l’Équipement et de l’Eau vient confirmer que ce qui était qualifié hier de “surenchère politique” est désormais une réalité reconnue par le gouvernement lui-même. Cela signifie-t-il que l’opposition avait raison ? Ou bien s’agit-il d’un véritable changement de vision du gouvernement en matière de gestion de l’eau ?
Une déclaration qui interpelle sur la responsabilité gouvernementale
Cette annonce place l’exécutif actuel face à une problématique majeure : si le secteur agricole a effectivement contribué à une consommation excessive de l’eau à un niveau aussi alarmant, qui en porte la responsabilité ? Y avait-il une stratégie claire et efficace pour la gestion de cette ressource essentielle ?
Certains observateurs estiment que cette déclaration pourrait être une remise en question implicite des politiques agricoles passées, longtemps pilotées par l’actuel chef du gouvernement lorsqu’il était ministre de l’Agriculture. Faut-il y voir une forme de critique implicite des choix stratégiques opérés sous son mandat, ou bien une simple prise de conscience dictée par la raréfaction des ressources en eau et l’évolution des priorités ?
Un recul réel ou une conséquence naturelle de la sécheresse ?
La baisse annoncée de l’utilisation agricole de l’eau, passant de 85 % à 55 %, pose également plusieurs interrogations méthodologiques :
- Quels critères ont été utilisés pour mesurer cette diminution ?
- S’agit-il d’un véritable succès des politiques de gestion de l’eau, ou simplement d’une conséquence naturelle des années de sécheresse et de la baisse du niveau des barrages ?
- Les cultures les plus gourmandes en eau ont-elles réellement été réduites, ou bien l’agriculture continue-t-elle d’en consommer d’importantes quantités, mais sous une forme différente ?
Au-delà du débat politique, des solutions concrètes sont nécessaires
L’eau est une ressource stratégique qui ne devrait pas être instrumentalisée politiquement. Désormais, après l’aveu officiel de cette surexploitation des ressources hydriques, il est impératif de se concentrer sur les solutions plutôt que sur les polémiques.
L’enjeu n’est pas seulement de reconnaître le problème, mais d’élaborer des politiques claires et efficaces, avec des mesures concrètes et des transformations structurelles permettant d’assurer la sécurité hydrique du pays sans nuire à l’un des piliers de l’économie nationale, à savoir le secteur agricole.
Reste à savoir si cette reconnaissance gouvernementale marquera le début d’un véritable changement de politique en matière d’eau et d’agriculture, ou si elle se limitera à une déclaration circonstancielle sans réel impact sur les orientations futures du gouvernement.