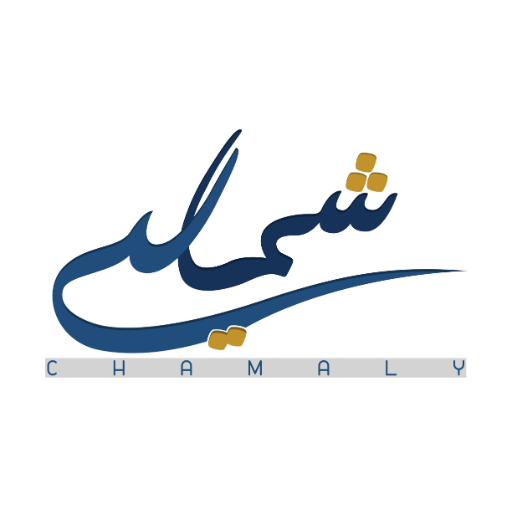Le Maroc connaît ces dernières semaines une forte hausse des recherches sur le mot “ADN”, en parallèle d’un vaste débat public autour de l’utilisation des analyses génétiques dans la justice, la filiation et les enquêtes criminelles.
Mais qu’est-ce qui explique cet intérêt renouvelé ? Et quel est le cadre juridique qui régit cette technologie dans le Royaume ?
Entre le laboratoire et la loi : où en est le Maroc ?
Depuis l’introduction des analyses génétiques dans le système judiciaire marocain au début des années 2000, le test ADN est devenu un outil scientifique essentiel pour établir la vérité dans les affaires criminelles : meurtres, viols, ou identification de corps non reconnus.
Mais le véritable débat surgit lorsqu’il s’agit d’établir la filiation (la paternité).
Alors que les scientifiques affirment que le test ADN offre une précision quasi absolue (plus de 99,9 %), le droit marocain, basé sur le Code de la famille (Moudawana), stipule que la filiation ne peut être reconnue qu’à l’intérieur du mariage légal.
Ainsi, les résultats des tests ADN ne sont pas admis pour prouver la paternité d’enfants nés hors mariage.
Le débat autour de la Moudawana : la vérité scientifique face au texte religieux
Au cours des derniers mois, le sujet de l’ADN est revenu sur le devant de la scène avec les discussions autour de la réforme du Code de la famille.
De nombreuses associations de défense des droits et plusieurs chercheurs plaident pour l’adoption du test ADN comme moyen de preuve de filiation, afin de protéger les droits des enfants et des mères célibataires.
À l’inverse, certains oulémas et juristes religieux estiment que l’introduction de cette pratique pourrait créer des contradictions avec les fondements de la charia, rappelant que la filiation découle du “lit conjugal” (al-firâch) et non d’un examen de laboratoire.
L’ADN au service de la justice criminelle : une révolution silencieuse
Loin du tumulte social, le domaine du profilage génétique judiciaire connaît une avancée majeure au Maroc.
Les laboratoires spécialisés relevant de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) ont réussi à résoudre plusieurs affaires complexes grâce à l’analyse des empreintes génétiques, plaçant le Maroc parmi les pays pionniers en Afrique et dans le monde arabe à disposer d’une base nationale de données ADN.
L’exemple récent de l’affaire d’Aïn Aouda, où les tests ADN ont permis de confirmer des liens familiaux dans une enquête criminelle sensible, a fortement stimulé l’intérêt du public pour cette technologie.
Entre science et religion : la nécessité d’un dialogue serein
De nombreux experts estiment que le choc entre la logique scientifique et la référence religieuse n’est pas inévitable.
La solution réside dans un cadre juridique équilibré, garantissant les droits individuels tout en respectant les valeurs spirituelles et culturelles du pays.
Utilisé avec éthique et transparence, le test ADN peut devenir un outil de justice et de dignité humaine, plutôt qu’un sujet de discorde.