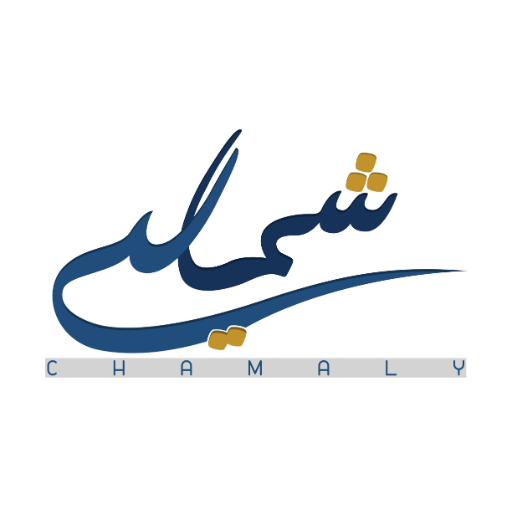L’ancien ministre de la Justice et des Libertés, Me Mustapha Ramid, a affirmé que le projet de nouveau Code de procédure pénale, malgré ses avancées et réformes importantes, ne répond pas suffisamment aux exigences de conformité avec la Constitution et les conventions internationales ratifiées par le Maroc, notamment en ce qui concerne le droit du suspect à l’assistance d’un avocat dès la phase de l’enquête préliminaire menée par la police judiciaire.
Dans un article approfondi intitulé « La présence de l’avocat avec le suspect devant la police à la lumière des conventions internationales », Ramid a souligné que le moment législatif actuel est « crucial et décisif », car il doit combler les lacunes et corriger les insuffisances du Code de procédure pénale. Selon lui, le texte proposé « répond à de nombreuses attentes, mais néglige des aspects essentiels de la protection des droits et libertés, notamment la possibilité pour l’avocat d’être présent dès la phase de l’enquête ».
Ramid a ajouté que cette question dépasse le cadre purement procédural : elle touche au cœur de la protection de la dignité humaine et à la crédibilité du travail sécuritaire et de la justice pénale, car les procès-verbaux de la police judiciaire constituent la base sur laquelle reposent les poursuites. « Tout doute sur les conditions dans lesquelles ces procès-verbaux sont établis affaiblit la confiance dans la justice, nuit à la réputation des institutions sécuritaires et, au-delà, à l’image des droits humains de l’État », a-t-il souligné
La Constitution et les conventions internationales au cœur du débat
Ramid a rappelé que l’article 120 de la Constitution marocaine stipule explicitement que « toute personne a droit à un procès équitable », ce qui, selon lui, ne saurait être garanti si les procès-verbaux sur lesquels repose l’accusation sont établis en l’absence de l’avocat.
Il a également rappelé le préambule de la Constitution, qui dispose que les conventions internationales dûment ratifiées par le Maroc priment sur la législation nationale, dans le respect de la Constitution, des lois du Royaume et de son identité nationale, engageant ainsi l’État à adapter sa législation à ces conventions.
Sur cette base, Ramid a souligné que trois conventions internationales majeures imposent au Maroc, explicitement ou implicitement, de garantir aux suspects l’assistance de leur avocat dès la phase de l’enquête :
1. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
2. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
3. La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.
Des lectures onusiennes qui confortent le droit à l’assistance d’un avocat
L’ancien ministre a évoqué les positions des organes onusiens, précisant que le Comité des droits de l’homme a interprété largement l’article 14 du Pacte international, consacrant le droit au contact avec un avocat dès le moment de l’arrestation.
Il a cité plusieurs décisions et communications onusiennes, notamment la communication n° 1769/2008 (affaire Bundaï c. Ouzbékistan), dans laquelle le Comité a estimé que priver un suspect de contact avec son avocat pendant l’interrogatoire constitue une violation des paragraphes (3 b) et (3 d) de l’article 14, et même une violation autonome du paragraphe (3 g) si les aveux ont été obtenus sous la torture.
Ramid a également rappelé la communication du Groupe de travail sur la détention arbitraire n° 40/2012 adressée au gouvernement marocain, ainsi que des avis ultérieurs, notamment lors de la 96ᵉ session d’avril 2023, qui ont réaffirmé que « le refus d’accès à un avocat viole le principe d’égalité des armes et le droit à un procès équitable devant un juge indépendant et impartial ».
Il a mentionné de même les positions du Comité contre la torture et du Rapporteur spécial sur la torture, qui ont souligné à maintes reprises que « tout aveu obtenu d’une personne privée de liberté, en l’absence d’un juge ou d’un avocat, ne peut avoir aucune valeur probante devant un tribunal ».
Avertissement contre l’impact sur l’image du Maroc en matière de droits humains
Ramid a considéré que ces positions et jurisprudences onusiennes sont désormais convergentes et répétées, si bien que tout État dont la législation ne garantit pas la présence de l’avocat pendant les interrogatoires est exposé à des appréciations négatives, telles que des accusations de détention arbitraire ou de torture. Et ce, même en l’absence de preuves tangibles, puisque la charge de la preuve repose sur l’État, et l’absence d’avocat est perçue comme une présomption de violation devant les mécanismes onusiens.
Il a ajouté que l’absence de cette garantie dans le projet du Code de procédure pénale rend le système législatif marocain non conforme à ses engagements internationaux, exposant ainsi les institutions sécuritaires et judiciaires à des soupçons susceptibles de ternir leur réputation si les tribunaux continuent de se fonder sur des procès-verbaux établis sans la présence de l’avocat.
De la conformité juridique au défi des droits humains
En conclusion, Ramid a appelé à introduire de nouvelles dispositions législatives garantissant la présence de l’avocat avec le suspect durant les interrogatoires, tout en proposant une période transitoire jusqu’en 2030 pour permettre aux institutions sécuritaires et judiciaires de se préparer à l’application effective de ce principe, en cohérence avec les préparatifs du Maroc pour la Coupe du monde 2030, organisée conjointement avec l’Espagne et le Portugal.
« De même que le Maroc œuvre à être au niveau de ses partenaires en matière d’organisation et d’infrastructures, il doit aussi être à leur hauteur dans le respect des droits humains et des garanties d’un procès équitable », a-t-il déclaré.
L’ancien ministre a conclu en exprimant sa confiance dans la capacité du Maroc et de ses institutions à relever ce double défi législatif et juridique, rappelant que « le Maroc a maintes fois démontré qu’il sait concilier ses ambitions de développement avec ses engagements en matière de droits humains ».