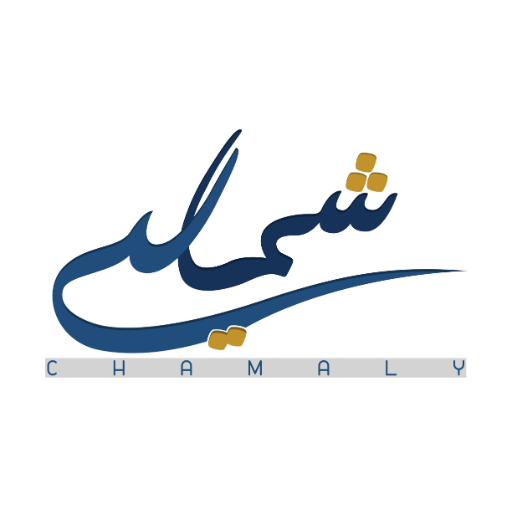Après plusieurs années de fermeture des frontières commerciales avec les villes de Ceuta et Melilla, le débat revient sur la possibilité de leur réouverture. Cette question soulève de nombreuses interrogations quant aux bénéficiaires réels de cette décision et à son impact sur le commerce local, notamment face aux tentatives de certains acteurs de contourner les droits de douane et les frais portuaires marocains.
Qui bénéficiera le plus de l’ouverture des frontières ?
Alors que la discussion sur la réouverture des points de passage commerciaux de Ceuta et Melilla s’intensifie, le Maroc se trouve face à un choix stratégique crucial qui déterminera l’avenir de sa politique économique et commerciale. D’une part, le maintien de la fermeture des frontières renforce le rôle du port de Tanger Med en tant que hub commercial international, assurant un contrôle strict du flux des marchandises conformément aux réglementations douanières en vigueur. Cette mesure protège l’économie locale contre le dumping commercial et garantit une concurrence équitable entre producteurs et importateurs marocains.
D’autre part, la réouverture des frontières pourrait relancer l’activité commerciale dans les deux enclaves et les villes environnantes. Toutefois, cela risquerait également de favoriser le retour d’un commerce échappant aux contrôles douaniers marocains, entraînant une baisse des recettes fiscales et une concurrence déloyale sur le marché intérieur, où certaines marchandises bénéficieraient d’avantages tarifaires non appliqués aux autres importateurs marocains.
Pas d’industries à Ceuta et Melilla pour justifier un tel flux de marchandises
Ces deux villes ne possèdent ni industries majeures ni infrastructures de production susceptibles de justifier l’ampleur des marchandises qui transitaient auparavant vers le Maroc. Ainsi, la logique économique voudrait que les importations se fassent directement via le port de Tanger Med, plutôt que par des circuits non contrôlés.
Un passage obligé vers les portes du commerce international
La fermeture des frontières a contraint la Chine à utiliser des ports internationaux. L’accès via Eurogate, qui permet des procédures accélérées au sein de l’Union européenne, n’étant plus une option, les marchandises chinoises doivent désormais passer par des voies commerciales internationales plus réglementées et plus lentes, ce qui représente un coût important pour les expéditeurs. Chaque jour de retard dans l’acheminement des marchandises entraîne des pertes financières significatives pour les entreprises chinoises.
Tanger Med : l’alternative légale et structurée
Le Maroc a promu le port de Tanger Med comme une alternative stratégique et réglementée pour l’importation de marchandises. Cette infrastructure offre des procédures douanières modernes et transparentes, garantissant ainsi des flux commerciaux conformes aux lois internationales, loin des pratiques de contrebande qui dominaient autrefois les passages frontaliers terrestres fermés.
Un choix stratégique pour le Maroc
La réouverture des frontières commerciales de Ceuta et Melilla pourrait générer des avantages pour certains acteurs, mais elle représenterait également un risque économique majeur pour le Maroc. Parmi les principaux bénéficiaires potentiels figurent les entreprises chinoises, qui pourraient éviter les taxes douanières et les frais portuaires marocains en exploitant le commerce informel pour inonder le marché local avec des produits bon marché sans passer par les circuits officiels.
L’Espagne pourrait également tirer profit de cette réouverture en relançant l’activité économique des enclaves, dont l’économie a été lourdement impactée par la fermeture des frontières. Ceuta et Melilla pourraient ainsi retrouver leur rôle de plaques tournantes du commerce transfrontalier, contribuant ainsi à atténuer la pression économique qui pèse sur l’Espagne.
Par ailleurs, la réouverture des frontières pourrait favoriser le retour du commerce informel, une activité dont dépendaient des milliers de personnes vivant du transport de marchandises de manière non régulée. Cela pourrait compromettre les efforts du Maroc visant à renforcer le commerce structuré et à lutter contre l’économie informelle.
En revanche, l’économie marocaine pourrait être la grande perdante dans ce scénario, car une concurrence accrue avec les produits de contrebande mettrait en péril les industries locales et les commerçants en règle. Cela pourrait freiner les investissements et le développement industriel, affaiblissant ainsi la stratégie du Maroc visant à construire un modèle économique basé sur un commerce organisé et équitable.
Alternatives pour les ex-trafiquants et dynamisation de la zone d’activités économiques de Fnideq
Après la fermeture des points de passage, des milliers de travailleurs du commerce informel se sont retrouvés confrontés à des défis économiques majeurs, rendant indispensable la mise en place d’alternatives économiques réelles et durables pour cette catégorie. Dans ce contexte, les autorités marocaines s’efforcent de développer la zone d’activités économiques de Fnideq afin d’en faire un pôle commercial et industriel capable d’offrir des opportunités d’emploi légales et stables, loin de l’économie informelle. Malgré les efforts en cours, il est nécessaire d’adopter des solutions innovantes pour exploiter pleinement cette zone, en attirant davantage d’investisseurs, en offrant des incitations fiscales et en simplifiant les démarches administratives, afin de créer un environnement commercial dynamique contribuant à la croissance économique de la région. De plus, le soutien aux petites et moyennes entreprises, ainsi que le développement de programmes de formation professionnelle adaptés, pourraient représenter une alternative durable, permettant aux ex-trafiquants d’intégrer l’économie formelle et d’assurer une stabilité socio-économique pérenne.